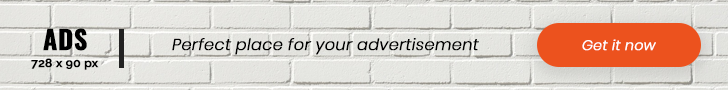Notion de “Terrorisme” au Bénin : Un expert de l’ONU relève les insuffisances du Code Pénal

Du 18 au 27 novembre, a séjourné au Bénin, Ben Saul, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Au titre de ses observations, il invite le Bénin, à restreindre et à préciser la définition du terrorisme et des infractions terroristes en vertu des articles 161 et suivants du code pénal afin d’assurer que la loi n’inclut que les actes qui constituent véritablement du terrorisme et qu’elle s’aligne sur les normes internationales : “Depuis 2019, des centaines d’arrestations, dont beaucoup semblent arbitraires ou sans notification adéquate des raisons de l’arrestation, ont été effectuées en relation avec des crimes liés au terrorisme”, fait savoir le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste.
Extrait de son constat sur la notion du terrorisme selon le code pénal béninois:
La définition d’un acte de terrorisme dans les articles 161 à 163 du Code pénal reflète en partie les meilleures pratiques internationales. À l’article 161, les éléments d’intention spécifiques, à savoir “dans le but d’intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publiques » sont tirés de la directive antiterroriste 2017 de l’Union européenne, et ces éléments, à leur tour, sont tirés de la Convention sur le financement du terrorisme de 1999 et de la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité. Les exigences d’intimidation « grave » ou de contrainte « indue », tirées du droit de l’UE, élèvent le seuil des actes terroristes et garantissent ainsi que le terrorisme est limité aux cas les plus graves. L’exigence contextuelle cumulative selon laquelle l’acte « peut porter atteinte à l’État » est également reflétée dans le droit de l’UE et limite davantage le champ d’application des infractions, bien que cet élément soit ambigu et puisse rendre l’application de la loi incertaine.
Lire Aussi : Cour africaine des droits de l’homme : L’Onu encourage le Bénin à reconsidérer son retrait
En outre, cet élément exige seulement que l’acte « puisse » nuire gravement à l’État, alors qu’il serait préférable d’exiger que l’acte cause effectivement un tel préjudice. Le problème le plus important de la définition est qu’elle fournit trois éléments d’intention spécifiques supplémentaires et alternatifs : « pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d’autres pays ou à une organisation internationale ».
Chacun de ces éléments va au-delà des normes internationales en matière de bonnes pratiques, car leurs termes sont vagues et trop larges, ce qui est contraire au principe de légalité énoncé à l’article 15 du PIDCP, qui exige que les infractions soient définies avec suffisamment de clarté et de spécificité pour que les individus puissent connaître à l’avance l’étendue de leur responsabilité. Les références vagues aux valeurs fondamentales de la société, aux structures nationales et aux intérêts des États étrangers risquent également de criminaliser l’exercice légitime des libertés civiles et politiques.
L’élément « déstabiliser les structures » est basé sur un élément très critiqué de la directive européenne susmentionnée (voir OTH 133/2024). L’abrogation de ces éléments contribuerait également à rendre la définition du Code pénal plus cohérente avec la définition de l’acte terroriste figurant à l’article 2 de la loi n° 2024-01 récemment adoptée par le Bénin sur le financement du terrorisme, qui s’inspire étroitement de la Convention sur le financement du terrorisme de 1999.
Le Bénin devrait également envisager d’exclure de la définition (a) les actes de protestation démocratique qui ne causent pas de morts ou de blessures graves ; (b) l’acheminement de secours humanitaires impartiaux ; et (c) les activités des forces armées dans les conflits armés régis par le droit international humanitaire. Infractions terroristes La définition du Code pénal contient une liste longue et complexe de 21 actes terroristes différents dans les articles 162 à 163. Nombre d’entre eux vont bien au-delà des normes internationales de bonne pratique sur la définition du terrorisme1 en englobant des actes qui ne constituent pas des infractions au titre des conventions internationales de lutte contre le terrorisme ou qui n’ont pas l’intention de causer la mort ou des dommages corporels graves.
À l’article 162, il s’agit notamment d’infractions en matière informatiques (cybercriminalité), d’infractions en matière de transport, d’armes conventionnelles et d’activités liées aux munitions, tandis que l’acte consistant à porter « atteinte à la sécurité intérieure et/ou extérieure de l’État » fait l’amalgame entre un autre type de menace pour la sécurité nationale et le terrorisme. À l’article 163, il s’agit de certains actes causant des pertes économiques ou des dommages matériels considérables, de la dégradation de l’environnement et de l’utilisation du territoire national ou de navires/avions nationaux pour commettre des actes de terrorisme contre les simples « intérêts » d’un autre État. À l’article 163, paragraphe 10, l’infraction ‘ »d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux » confond les éventuels discours de haine avec le terrorisme. Certaines des autres infractions visées à l’article 163 exigent que l’acte ait « pour effet de mettre en danger la vie humaine », mais ces infractions ont une portée excessive car elles n’exigent pas que la personne ait l’intention de mettre la vie en danger, ce qui réduit la responsabilité à un niveau trop faible.
L’article 163 mélange également de manière confuse les infractions terroristes substantielles (par exemple l’article 163, paragraphes 1 à 4) avec les infractions préparatoires ou inchoatives (telles que l’entraînement, le recrutement, les infractions liées aux groupes terroristes, l’utilisation du territoire pour les préparatifs, les infractions liées aux armes, l’incitation, le soutien, la dissimulation et les menaces), alors que ces dernières devraient être distinguées des « actes terroristes » qu’elles facilitent, et que les sanctions devraient être différenciées. L’article 163, paragraphe 10, du Code pénal érige en infraction pénale le fait « d’appeler, par n’importe quel moyen, à commettre des actes de terrorisme, d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux, ou d’utiliser un nom, un terme, un symbole ou tout autre signe dans le but de faire apologie d’une organisation terroriste, de l’un de ses dirigeants ou de ses activités ».
L’imprécision du terme « apologie » peut porter atteinte au principe de légalité et permettre une utilisation potentiellement abusive de la loi pour restreindre l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression. Le Comité des droits de l’homme a souligné que les interdictions « d’encouragement », « d’éloge”, “d’apologie » ou de « justification » du terrorisme ou d’activités extrémistes doivent respecter les exigences strictes relatives à la limitation de la liberté d’expression pour des raisons de sécurité nationale ou pour protéger les droits d’autrui, conformément à l’article 19, paragraphe 3, du PIDCP.
Les lois relatives à l’expression liée au terrorisme doivent:i) être précisément prescrites par la loi et éviter les termes vagues; ii) être fondées sur une définition sousjacente précise du terrorisme; iii) être strictement nécessaires et proportionnées; iv) et inclure à la fois l’intention d’inciter au terrorisme et le risque objectif qu’il soit commis (A/HRC/16/51, par. 31). La définition d’une « organisation terroriste » à l’article 165 du Code pénal semble confondre le concept ou la définition d’une organisation terroriste avec les modes de participation criminelle à une telle organisation, à savoir la tentative, la complicité, l’organisation ou l’incitation, et la conspiration.
La confusion est d’autant plus grande que l’article 163(5) du Code pénal traite également d’un type de conspiration organisationnelle. Ces dispositions créent une incertitude inutile quant à l’étendue de la responsabilité pénale liée aux groupes terroristes et devraient être simplifiées pour renforcer la sécurité juridique et réduire toute duplication. Sanctions L’article 166 du Code pénal prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour tout personne coupable d’actes de terrorisme. Cette disposition semble imposer une peine obligatoire pour tous les cas de terrorisme, indépendamment des caractéristiques d’un crime particulier, de la situation de l’auteur de l’infraction ou de toute circonstance atténuante. La gravité des actes terroristes varie considérablement d’un cas à l’autre, en particulier lorsque la définition du terrorisme couvre un très large éventail d’actes, comme c’est le cas dans la législation béninoise.
Le principe de proportionnalité dans la détermination des peines pénales exige que la sanction pour un crime reflète sa gravité et le degré de culpabilité de l’auteur. Les peines proportionnées peuvent également encourager la réinsertion en offrant aux personnes condamnées la possibilité d’être libérées et réintégrées dans la société, alors que les peines de réclusion à perpétuité compromettent les perspectives de réinsertion, y compris la déradicalisation des auteurs d’actes de terrorisme.